Accueil > Français > Livres, documents, revues, vidéos & audios > RECENSION - Piel blanca, máscaras negras : Crítica de la razón decolonial, (…)
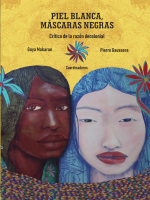 RECENSION - Piel blanca, máscaras negras : Crítica de la razón decolonial, de Gaya Makaran et Pierre Gaussens
RECENSION - Piel blanca, máscaras negras : Crítica de la razón decolonial, de Gaya Makaran et Pierre Gaussens
Claude Bourguignon Rougier
lundi 21 décembre 2020, mis en ligne par
– México, Bajo Tierra et Centre de recherches sur l’Amérique latine et les Caraïbes - Université nationale autonome du Mexique (UNAM)
– 2020, 344p, 23 x 17 cm
– ISBN UNAM : 978-607-30380-4-1
– ISBN Bajo Tierra : 978-607-98901-6-2
Vient de sortir, en espagnol, aux éditions Bajo Tierra, Piel blanca, máscaras negras. Crítica de la razón decolonial. Il s’agit d’une anthologie coordonnée par Pierre Gaussens et Gaya Makaran, composée d’articles écrits entre 2010 et 2020 par des auteurs vivant des deux côtés de l’Atlantique. Dans la première partie, ce travail regroupe des critiques de la théorie décoloniale, et, dans la deuxième, des articles de penseurs latino-américains ou espagnols, qui proposent des analyses liées à la critique de l’extractivisme ou à la perspective féministe autonome. Nous n’aborderons pas ici cette seconde partie de l’ouvrage, qui ne concerne pas le courant décolonial.
Le choix du titre annonce l’état d’esprit, sinon de tous les auteurs, du moins des coordinateurs. « Peaux blanches, masques noirs », est l’inversion malveillante du titre d’un ouvrage célèbre de Fanon. Quant à l’introduction, intitulée « Autopsie d’une imposture théorique », elle est d’emblée disqualification en même temps que certificat, un peu rapide, de décès. En cela, au début de cet ouvrage, nous sommes face à une attitude qui ne se différencie pas vraiment des rares critiques faites en France de l’approche décoloniale, plus proches de l’évacuation que de l’analyse. L’idée d’imposture est déclinée sous plusieurs angles : imposture qu’il y a à revendiquer l’héritage antiraciste d’un Frantz Fanon instrumentalisé et décontextualisé ; imposture d’auteurs qui s’auto-proclament porte-parole des peuples autochtones victimes de la colonisation mais soutiennent des régimes qui, sous couvert de progressisme et de plurinationalité, contribuent en fait à désarmer les mouvements indigènes ou écologistes ; imposture théorique d’intellectuels affamés de reconnaissance, qui ne peuvent suppléer par l’abus de néologismes la faiblesse de leur pensée. Axée sur l’essentialisation de l’Europe et de l’Occident et la division manichéenne du monde entre dominants et dominés, leur théorie opèrerait un tour de passe passe en remplaçant la classe par la race. Le petit monde du décolonial, arque-bouté sur sa critique de l’eurocentrisme, ne chercherait en fait qu’à occuper l’Université et voudrait y prendre la place qu’y tint jadis la pensée marxiste. Face à ce qu’ils voient comme une indigence théorique, les auteurs proposent d’abord de déconstruire les insuffisances de l’approche décoloniale, et ensuite, de s’ouvrir à d’autres penseurs, en lutte contre le colonialisme eux aussi, mais plus proches de la base, du mouvement social.
Pierre Gaussens et Gaya Makaran hypostasient la figure de Walter Mignolo, au détriment des autres. Cela les amène à réduire un courant hétérogène à une seule et même perspective. Lorsqu’ils évoquent, par exemple, le rejet du marxisme des décoloniaux, ils font preuve d’une méconnaissance regrettable de la production de certains auteurs. Ils ignorent Enrique Dussel et ses écrits sur les Grundrisse [1], ou Aníbal Quijano et son long itinéraire marxien, si hétérodoxe qu’il lui a valu de sérieuses déconvenues avec la doxa latino-américaine de l’époque.
Néanmoins, il faut reconnaître qu’ils pointent certaines insuffisances ou contradictions réelles. Et il est finalement assez salutaire, comme ils le proposent, de décoloniser les approches décoloniales, en appliquant à leurs auteurs les principes de décolonisation épistémique qu’ils préconisent. Critiquant une vision de l’Europe simpliste parce qu’univoque, une lecture de l’histoire simplificatrice, une vision de la domination qui oppose mécaniquement dominants et dominés, Pierre Gaussens et Gaya Makaran incriminent, avec raison, la rareté de travaux empiriques venant corroborer les postulats décoloniaux (mais là encore, ils oublient tout le travail d’un sociologue comme Quijano, entre autres sur le métissage, sur le cholo péruvien [2], ou celui d’un Arturo Escobar sur les mouvements afrocolombiens, où encore les analyses de Fernando Coronil sur l’économie du pétrole au Venezuela [3].
D’autre part, parler comme ils le font de rejet des auteurs européens par les décoloniaux n’est justifié que pour certains d’entre eux, surtout Walter Mignolo et Ramón Grosfoguel, pas pour Arturo Escobar, Santiago Castro Gómez, très bons connaisseurs de l’œuvre de Foucault ou de Bourdieu pour le second. Enfin, la présentation du courant comme une escroquerie théorique met mal à l’aise. Et ce d’autant plus qu’elle rappelle les procédés dont abusent certains intellectuels décoloniaux qui disqualifient leurs contradicteurs au lieu de leur répondre. La critique a besoin de sérénité et les indéniables faiblesses du courant décolonial n’autorisent pas à l’envoyer ad patres.
Mais l’intérêt de cet ouvrage est qu’il rassemble des articles qui ont des optiques diverses ; nous avons un groupe d’analyses émanant d’auteurs globalement hostiles à l’approche décoloniale, identifiée à un coup de force dans le champ académique. C’est le cas des articles de Rodrigo Castro Orellana, Bryan Jacob Bonilla Avendaño et Jeff Browitt. Il y a également des textes qui s’attaquent à un point précis de l’approche décoloniale, ce que fait Daniel Inclán avec sa critique de la philosophie de l’histoire décoloniale, ou l’abordent de biais, comme Philippe Corcuff lorsqu’il s’intéresse à un mouvement social français qui a dialogué avec le courant décolonial latino-américain, le Parti des indigènes de la République. Enfin, nous avons des analyses, comme celles de Martín Cortés ou Gregory Fernando Pappas qui insèrent la perspective décoloniale dans l’histoire de la pensée critique latino américaine tout en mettant en garde contre les impasses de ce courant.
La perspective décoloniale comme escroquerie théorique
Dans le premier groupe, on trouve le texte de Rodrigo Castro Orellana intitulé « Le côté obscur de la colonialité. Anatomie d’une inflation théorique ». L’auteur y aborde les problèmes posés par des notions comme celles de « différence coloniale », ou « pensée frontalière [4] ». La différence coloniale serait un concept problématique car elle désigne tantôt une réalité préexistant à la mise en place du système colonial, tantôt le produit de sa domination. L’auteur analyse la construction du champ d’études décoloniales par Mignolo et le rôle qu’y joue le concept d’occidentalisme. Pour le sémioticien argentin, l’occidentalisme est lié à la première colonisation ibérique, l’orientalisme étant l’effet de la deuxième colonisation. Cela l’amène à affirmer l’opposition entre un discours de l’annexion (l’occidentalisme ) et un discours de la différence (orientalisme). Dans le cas de l’orientalisme, la différence viendrait d’une altérité construite à l’intérieur d’un ordre discursif, et dans celui de l’occidentalisme, l’altérité serait une réalité extérieure, incorporée à l’épistémè hégémonique. Si on part du discours de la différence avec les études post-coloniales, on reste sur le terrain euro-centré, alors que partir d’un post-occidentalisme serait prendre les choses à la racine. Le problème c’est que la « différence coloniale » qui permet cette radicalité devient parfois une stratégie discursive impériale, ce qui revient donc pour l’auteur à scier la branche sur laquelle il s’est assis.
Cette dualité propre au concept de différence coloniale réapparaît dans celui de pensée frontalière, qui désigne à la fois un lieu d’énonciation et un type d’énonciation. La question du lieu d’énonciation joue un rôle essentiel dans la perspective de Mignolo. L’histoire des pays qui furent colonisés a été racontée par les anciens colonisateurs, ceux-là même qui ont créé une correspondance entre domination politique et domination épistémique en attribuant aux habitants zones colonisées des capacités cognitives et un pouvoir d’énonciation inférieur à celui des habitants des zones colonisatrices, le racisme étant le mode d’existence de cette différence. Il s’agit donc pour Mignolo de déplacer le lieu de l’énonciation, à partir d’une mise en question de la situation géographique et géo-historique du sujet qui connaît. La frontière désigne les positions épistémiques situées à la limite du système monde moderne/colonial. Avec la pensée frontalière, Mignolo trouve le locus d’énonciation qui permet de critiquer l’universalisme moderne et d’élaborer une épistémologie subalterne. Celle-ci est la réponse donnée aux designs globaux à partir d’une situation subalterne, locale, celle de la chicana, par exemple. Cette pensée peut se pratiquer du côté des frontières internes ou externes, depuis la différence impériale (à l’intérieur de la modernité) ou depuis la différence coloniale (à l’extérieur de la modernité). La critique développée depuis l’intérieur est une pensée faible, et celle qui est construite à partir de l’extérieur, une pensée forte. L’idée étant qu’il faut penser à partir de la douleur de l’expérience de la colonialité
L’auteur s’attache à déconstruire le privilège épistémique de la victime affirmé par Mignolo, à partir de la critique de cette même pensée frontalière. Reprochant à cette dernière de reposer sur la seule localisation de la pensée dans un extérieur à la pensée hégémonique, il met en question la différence entre la pensée frontalière de la victime, et la pensée frontalière « faible », élaborée par celui qui endosse le point de vue de la victime sans l’être. Il trouve injustifiée la prééminence accordée au point de vue de la victime et critique la dichotomie modernité/extériorité originelle sur laquelle repose ce privilège. Rodrigo Castro Orellana pense qu’il faut penser des espaces traversés par des logiques hétérogènes. Pour cela, il s’appuie sur les constructions de Santiago Castro Gómez [5], philosophe colombien qui a participé au projet Modernité/Colonialité à partir d’une position originale. Castro Gómez regrette que la plupart des auteurs décoloniaux réalisent une lecture molaire de la colonialité » au lieu de s’engager, sur les traces de Michel Foucault, dans une micro physique du pouvoir. La vision de certains auteurs décoloniaux pécherait donc par son renvoi implicite à une vision du pouvoir conçu comme pure domination, avec l’idée d’un point central à partir duquel celui-ci se diffuserait. Une telle conception est inséparable d’un concept de totalité auquel les auteurs n’auraient pas renoncé, même s’ils disent pis que pendre de Hegel. Rodrigo Orellana reprend à son compte l’idée de Castro Gómez : la critique décoloniale est possible parce qu’à un moment donné, avec l’avènement de la modernité, les savoirs qui circulaient jusque-là en circuit fermé ont pu gagner le reste de la société. L’histoire latino-américaine, par exemple les guerres d’indépendance, montrerait que ces savoirs n’ont pas seulement permis la consolidation du pouvoir politique des élites mais l’expression de leurs revendications par des groupes jusque-là exclus. En fait, en citant les travaux de Castro Gómez, Rodrigo Orellana rend compte d’une diversité interne au courant décolonial que plusieurs auteurs de l’anthologie passent à la trappe.
On remarquera d’ailleurs que le philosophe espagnol, lorsqu’il aborde la question de la culture, oublie l’approche qu’en ont certains représentants du courant comme Arturo Escobar. Exaspéré, ce que l’on peut comprendre, par la vision fossilisée des cultures autochtones de Mignolo, Rodrigo Castro Orellana insiste sur le caractère hybride de toute culture et sur l’absurdité de l’idée d’une authenticité originelle qui se serait maintenue à travers les siècles. On ne peut que le rejoindre : certes, l’hybridation est constamment à l’œuvre dans l’histoire. Mais si l’on ne veut pas en rester aux généralités, et évacuer ainsi la question délicate des continuités, il faut également voir que le monde est peuplé par des ontologies diverses. Elles traversent l’histoire, comme l’a montré Philippe Descola, certes en se transformant. Pour le Mexique, un Alfredo López Austin [6] a montré qu’aujourd’hui les Nahuas ont une conception des entités animiques dans laquelle se maintiennent certains aspects du monde pré-colombien. Pour le Pérou, une Marisol de la Cadena [7] a expliqué que l’ayllu était une ontologie et une cosmogonie autant qu’un type de propriété de la terre. Plutôt que de s’arrêter à la vision effectivement réductrice qu’a des cultures indigènes Mignolo, lequel est sémioticien, pourquoi ne pas se tourner vers Arturo Escobar, qui, lui, est un anthropologue ? Il s’intéresse depuis longtemps aux ontologies des Afrocolombiens du Pacifique et des Nasa du Cauca. Il a participé aux réunions du projet Modernité/Colonialité mais sa vision est bien différente : il explique que les Afrocolombiens du Proceso de Comunidades Negras articulent lutte politique, revendication d’une identité et du territoire à partir d’une inscription dans un passé qui n’est pas essentialisé, ni folklorisé [8] Leur praxis est précisément une reconstruction de ce que de nombreux auteurs de l’anthologie semblent pourtant appeler de leurs vœux. Il aurait été également souhaitable, à ce moment là de revenir sur les travaux d’un autre anthropologue, Restrepo, proche des décoloniaux, et sa conception politique de l’identité [9]
Regards de côté
L’article « Dispute autour de l’histoire : problème de l’intelligibilité du passé » remet en question l’opposition entre savoirs subalternes et savoirs du centre qui structure la perspective décoloniale, à partir d’une critique de sa philosophie de l’histoire. Selon Daniel Inclán, la contre-histoire que propose Enrique Dussel, entre autres lorsqu’il décrit un Orient qui aurait précédé l’Europe en termes de développement, est un récit qui fonctionne sur la base de la même historiographie, des mêmes méthodes historiques que ce qu’il remet en question. Dussel réalise une analyse qui prétend rééquilibrer le récit historique en dévoilant le rôle précurseur d’un Orient invisibilisé ou minoré par l’historiographie classique. Mais le philosophe argentin ne prend en compte que le développement du marché dans l’aire orientale, négligeant d’autres facteurs essentiels du développement, dont la question de l’accumulation, très problématique dans cette partie du monde. Les critères employés pour démontrer l’importance de l’aire orientale reposeraient sur des notions quantitatives, le nombre d’habitants des villes par exemple, la lecture péchant finalement par son positivisme. D’autre part, quand les auteurs décoloniaux font de 1492 la date fondatrice de la modernité, ils oublient que la colonisation a commencé en Europe, ce qu’avait déjà démontré Karl Polanyi avec La Grande Transformation [10]. Les populations européennes ont été les premières à essuyer ce colonialisme interne, et ce avant l’expansion du capitalisme hors d’Europe. Enfin, la vision de la culture de Dussel réduirait celle-ci au mouvement d’expansion ou de contraction de réalités univoques et escamoterait la question du déchiffrement de la langue des opprimés, question d’autant plus problématique qu’aucun des intellectuels du courant décolonial n’a fait l’effort d’apprendre une langue indigène. La tendance à la simplification de ces données empiriques expliquerait leur goût pour la problématique épistémique, l’analyse des processus sociaux complexes interdisant le refuge dans des généralités.
Daniel Inclán, comme les autres auteurs de l’ouvrage, incrimine l’abus de néologismes. Il s’interroge sur la pertinence d’une pensée qui recourt trop souvent à l’adjectivation. Elle atteint son comble dans des formules comme celle de « système-monde capitaliste/patriarcal/occidentalo-centré/christiano-centré/moderne/colonial » de Ramón Grosfoguel. L’auteur oppose à la vision de l’histoire du M/C la perspective temporelle de Bolívar Echeverría [11] qui parle de modernités plurielles, de Silvia Rivera Cusicanqui [12], ou d’Eduardo Grüner [13] avec son entre-lieu. Ces derniers ne font pas de la colonialité une conséquence inévitable de la modernité car ils ne pensent pas dans le cadre d’une pensée déterministe, et remettent en question le principe de cause à effet dans l’histoire. Enfin, l’auteur remarque qu’on ne peut pas réduire la colonisation à un processus de domination et d’exploitation puisque la Conquête a été également l’occasion de la mise en place d’autres processus de pouvoir. La question de l’identité américaine recouvrant pour lui une question politique, Daniel Inclán rejette l’idée d’une Amérique profonde. Il appelle de ses vœux une recherche qui prenne la peine de créer les concepts épistémiques nécessaires à son déploiement, sans quoi il est impossible de ne pas tomber, comme Dussel, dans une lecture positiviste du passé.
Dans « À propos de certaines mésaventures de la raison décoloniale ou post-coloniale : hommage critique et libertaire aux questionnements décolonisateurs », Philippe Corcuff affirme son intérêt critique pour les approches décoloniales, la décolonisation de la gauche et évoque l’espoir qu’a constitué pour lui l’appel des Indigènes de la République, en 2005, au moment des révoltes de banlieue. Il regrette que le mouvement, devenu parti en 2010, n’ait pas tenu ses promesses et se soit enfermé dans une vision qu’il considère communautariste et identitaire. Remettant en question un fonctionnement représentatif du PIR ancré dans un dispositif de savoir/pouvoir jamais questionné, l’auteur défend l’idée de mouvement sociaux dans lesquels l’intersectionnalité soit réelle, sans hiérarchie ou domination d’un critère, race, genre ou classe, sur les autres. Pour lui, les mouvements et les approches théoriques doivent être produits à partir du mouvement social, et non, comme c’est le cas avec le PIR, à partir d’un groupuscule d’intellectuels à fort capital intellectuel, prétendant parler au nom d’une base qui finalement ne les a pas ralliés.
On rejoindra l’auteur sur la plus grande partie de son constat, même si sa chronologie est discutable, dans la mesure où la sortie du livre d’Houria Bouteldja [14] en 2016, a créé de l’espoir, sinon dans les banlieues, dans une certaine partie de la classe moyenne de gauche. L’idée qu’il était possible de créer un mouvement antiraciste d’une autre nature a germé. Mais les Indigènes n’ont pas su créer une alliance avec la gauche, laquelle il est vrai, était assez squelettique. Et surtout, elle n’avait pas les outils théoriques lui permettant de rejoindre les Indigènes de façon critique, dans un vrai dialogue, pas une simple adhésion. Et le PIR a fait des choix stratégiques qui étaient des erreurs, soutenu des gens indéfendables au nom d’un traitement juridique égal pour tous.
Leur analyse souffre effectivement de la fermeture que dénonce Philippe Corcuff. Mais on ne sera pas d’accord avec lui lorsqu’il emploie les termes d’« essentialisme communautaire » et d’« identitaire ». En effet ce vocabulaire est celui de l’État français, un État qui met en avant une république abstraite tout en détruisant consciencieusement les fondements de la démocratie. Parler de communautarisme nous fait communier avec l’extrême droite ou les ultraconservateurs, auquel on ne reproche jamais d’être raciste parce qu’ils prennent soin de ne pas employer le mot race. Dans notre pays, on peut être raciste du moment qu’on n’emploie pas le terme. Inversement, lorsque certains font allusion à l’existence sociale de la race, on leur reproche un racisme inversé. On peut ne pas être d’accord avec le PIR, quand il emploie certaines catégories (les Blancs, dont on ne sait s’ils sont une catégorie à travers laquelle est appréhendée une logique raciste ou une donnée empirique), elles ont néanmoins le mérite d’attirer la question sur ce que nie l’État : le racisme structurel français. La rhétorique du PIR n’a pas abouti et nous n’avons pas encore élaboré les concepts qui permettraient de les déconstruire en le dépassant, et de développer, sans tomber dans les mêmes erreurs qu’eux, ce qu’ils ont su voir à un moment.
La perspective décoloniale et la pensée critique latino-américaine
La critique de Martin Cortés synthétise à la fois les contradictions des intellectuels décoloniaux et celle de plusieurs des auteurs de l’anthologie. En effet, la « pureté » et l’« authenticité », paradoxalement, sont le terrain commun aux partisans et aux adversaires du décolonial. La morale ou l’éthique, l’invocation de la vérité contre la manipulation, la prétention d’incarner plus authentiquement les intérêts des pauvres, des exclus, des opprimés, indigènes, subalternes, comme on souhaitera les nommer, empoisonne le débat. Cortés nous offre des pistes pour en sortir. L’article nous met en garde contre les périls de l’identité, de l’unité, ou de la nouveauté. À partir d’une réflexion sur sa propre lecture du marxisme et celle qu’opèrent les décoloniaux, Cortés revient sur la problématique de hétérogénéité et de l’origine. Fernando Ortiz avec son concept de transculturation [15], Antonio Cornejo Polar [16] avec son analyse de l’hétérogénéité culturelle avaient déjà eu conscience du danger d’un projet de détachement comme celui que propose Mignolo, à partir d’un retour à un extérieur préservé des contaminations de la modernité. Quijano se situait dans leur sillage, lorsqu’il employa la notion d’hétérogénéité structurelle, bien avant de fonder la théorie de la colonialité du pouvoir. Mais Quijano, contrairement à Mignolo, avait travaillé avec les tenants de la théorie de la dépendance, dans les années soixante et soixante-dix. Cortés remarque que c’est aussi grâce à eux que le sociologue péruvien a pu percevoir l’Amérique latine comme branchement de diverses réalités et diverses temporalités. Et il suggère qu’il serait bon de revenir vers ces auteurs dont la boite à outils pourrait nous aider à comprendre la reconfiguration néo-libérale du monde. Cet article sort du complexe polémique où s’enferment les décoloniaux et leurs adversaires. Il propose une synthèse : se réapproprier l’apport de Marx à partir de l’Amérique latine, réactualiser le cosmopolitisme d’un José Carlos Mariátegui [17] et, avec Oswaldo de Andrade, incorporer le « Tupi or not Tupi » du Manifeste anthropophage [18] Il s’agit de dévorer de façon originale l’apport de la pensée occidentale plutôt que de que le rejeter. Cette dévoration, qui a d’ailleurs commencé il y a longtemps, donne sa particularité à l’essai latino-américain et à la tradition critique du continent. Remettant en question l’idée de pureté et d’origine, Cortés inclut le courant décolonial dans cette généalogie, dans ce grand mouvement de retraduction des textes qui se réalise avec chaque génération. Tout texte nécessite une traduction. Il n’y a pas de texte définitif. Ni de nouveauté radicale.
L’article de Gregory Pappas met en regard la réflexion d’un philosophe mexicain zapatiste, Luis Villoro, et celle des décoloniaux. Son article questionne le caractère trop général du concept de colonialité sans le rejeter pour autant, montrant à quel moment il pose problème. « Les idées générales sont des idées de général » disait Virginia Woolf. Celle de colonialité, déclinable comme colonialité du pouvoir de la connaissance, de l’être, etc, semble pouvoir s’étendre indéfiniment, avec le risque de coloniser les autres catégories philosophiques. L’auteur applique aux décoloniaux les remarques de Luis Villoro. Celui-ci attaquait la vision de l’idéologie propre à la gauche latino-américaine, qui réduisait les croyances aux intérêts qui lui sont liés. Il regrettait l’importance donnée au contenu d’une croyance au détriment du rôle qu’elle jouait dans un contexte donné. Il notait qu’une croyance peut servir dans un contexte donné des intérêts autres que ceux qu’elle avait originellement défendus. D’où l’idée, en ce qui concerne les décoloniaux, que récupérer l’héritage indigène ne signifie pas nécessairement cheminer vers le bien, simplement parce que toutes les idéologies occidentales sont identifiées à l’impérialisme de l’Occident. Le plus grand problème que pose ce dualisme inversé n’est pas théorique mais politique : il peut amener à soutenir des politiques identifiées au camp du bien, sur la seule base de l’opposition à l’impérialisme occidental. D’autre part, une pensée basée sur une explication générale du monde a tendance à produire l’exclusion de ceux qui ne partagent pas ce credo, et à faire de ceux qui fournissent l’interprétation estampillée les leaders « naturels » du mouvement au détriment des autres. Et le fait qu’une philosophie n’aborde pas la question coloniale ne signifie pas qu’elle ne s’attaque pas à la domination car la fonction disruptive de la philosophie est en acte dans sa critique des croyances établies et elle n’a pas à prendre une forme directement politique, écrivait Villoro. Le sympathisant du zapatisme [19] appelle à résister à la tentation d’une croyance partagée et à rechercher plutôt un engagement moral collectif. Parler au nom des opprimés, des indigènes, par exemple, comporte un risque de ventriloquie, surtout lorsqu’on ne parle pas leur langue. Le problème ne tient pas tant au fait que le sens de concepts empruntés à une culture indigène puisse être modifié, mais qu’on n’en ait pas conscience. Plus que de parler en leur nom, il faut les écouter. Car les décoloniaux, y compris Grosfoguel, que n’immunise pas son concept d’extractivisme épistémique, peuvent coloniser la pensée indigène.
Conclusion
Cette anthologie a le mérite de poser des problèmes mais elle laisse sur une sensation mitigée, précisément pour les raisons évoquées plus haut. La volonté inquiétante de démasquer un mensonge se fonde sur une vision du travail « scientifique » insuffisamment problématisée. Quelles que soient leurs outrances et leurs carences, on ne peut pas traiter les intellectuels décoloniaux de faussaires, comme si on détenait la vérité. Que l’approche décoloniale soit trop souvent univoque, c’est un fait. Que la chronologie qu’elle établit soit discutable, c’est également vrai. Que son opposition Occident /Amérique latine soit caricaturale, c’est indéniable. Mais ce qu’elle pointe avec le concept de colonialité est là. Voilà pourquoi lorsqu’on traite d’imposteurs les intellectuels de ce courant, à une époque où le discours sur la vérité est accaparé et monopolisé par l’État, on parle le langage de ce dernier [20]. Il y a des attaques ad hominem dans ce livre, et la suffisance indéniable de certains décoloniaux ne justifie pas d’envoyer tout le monde aux orties. Le décolonial n’appartient pas aux intellectuels du projet M/C, il est ce que l’on en fait. La phase des pères fondateurs est close. L’approche décoloniale a changé avec les féministes décoloniales, avec les mouvements autonomes, avec la critique de l’extractivisme. Avec d’autres intellectuels, et d’autres militants, d’autres générations. C’est dans la dernière décennie du XXe siècle, en même temps que le « réveil indien », et les mouvements de revendication afro-américains, que ce courant est apparu. Il n’est en fait que la partie émergée de l’iceberg.
Coordinateurs, encore un effort pour décoloniser le décolonial.
[1] Enrique Dussel, La production théorique de Marx : Un commentaire des Grundrisse, Paris, l’Harmattan. 2009
[2] Anibal Quijano, Dominación y cultura : Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú, Lima, Mosca Azul, 1980.
[3] Fernando Coronil, El Estado mágico : Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, 1997.
[4] Walter Mignolo, « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique », Mouvements, n° 73, 2013.
[5] Santiago Castro Gómez, « Los desafíos de la posmodernidad a la filosofía latinoamericana », Dissens. Revista internacional de pensamiento latinoamericano, nº 1, 1995.
[6] Alfredo López Austin, Cuerpo humano e ideología : Las concepciones de los antiguos nahuas, México, Investigaciones antropológicas - UNAM.
[7] Marisol de la Cadena, « Indigenous Cosmopolitics in the Andes. Conceptual Reflections beyond Politics », Cultural Anthropology, vol. 25, 2010.
[8] Arturo Escobar, Sentir-penser avec la terre : Une écologie au-delà de l’Occident, Paris, Le Seuil, 2018.
[9] Eduardo Restrepo, « Diversidad, interculturalidad, et identidades », dans Maria Elena Troncoso [coord.], Cultura pública y creativa : Ideas y procesos, Buenos Aires. Ministerio de Cultura de la Nación, 2015.
[10] Karl Polanyi, La Grande Transformation : Aux origines politiques et économiques de notre temps, Paris, Gallimard, [1944] 1983.
[11] Bolivar Echeverría, La modernidad de lo barroco, México, Ediciones Era, 1998.
[12] Silvia Rivera Cusicanqui, Un monde ch’ixi est possible : Essais à partir d’un présent en crise [Édition originale en espagnol : Un mundo ch’ixi es posible : Ensayos desde un presente en crisis, éditions Tinta Limón, collection « Nociones comunes », Buenos Aires, 2018.
[13] Carlos Sergio Aguirre Aguirre, Pensamiento del entre-lugar y pensamiento fronterizo : (Des)articulaciones y emergencias en el espacio latinoamericano, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET digital, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2017.
[14] Houria Bouteldja, Les Blancs, les Juifs et nous, Paris, la Fabrique, 2016.
[15] Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y del azucar, La Havane, Jesus Montero Editores, 1940.
[16] Antonio Cornejo Polar, Escribir en el aire, Lima, Horizonte, 1994.
[17] Matthieu Renault, « ¿Puede haber una filosofia de la historia decolonial ? », Eidos, Revista de filosofia, n° 34, 2020.
[18] Oswaldo de Andrade, « Manifesto antropofágo », São Paulo, Revista de antropofagia, 1928.
[19] Luis Villoro, De la libertad a la comunidad, México, Ariel / ITESM, 2001.
[20] Voir l’analyse du lien entre État et sociologie de Pierre Bourdieu (Sur l’État, Paris, Seuil, 2012.

